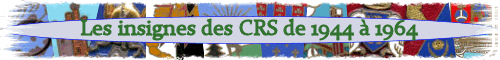 |
CRS 13 Lille (59) puis CRS 11 en 1947 |
||
 |
L’insigne fut créé à partir d’une carte postale représentant, place Richebé à Lille (59), la statue du Général Faidherbe sur son cheval, sa résistance à la tête de l’armée du Nord en 1870 épargna l’occupation allemande aux départements du Nord et du Pas-de-Calais.
Sur fond de gueule : la fleur de lys, symbole de la ville de Lille (59). Elle représenterait également la pointe d’une échelle d’assaut (lance de la pointe assortie de 2 crochets). Partie supérieure dextre : la croix de guerre décernée une première fois à la ville pour sa conduite lors de la guerre 1914-1918 et une seconde fois lors de la guerre 1939-1945 (citation à l’ordre de l’Armée) |
 |
CRS 14 Condé-sur-l’Escaut (59) dissoute en 1964 |
||
 |
La CRS 14 est issue du GMR Vauban qui était en cours de création en juin 1944. Elle s’installa caserne Nesle-Lecomte à Condé-sur-Escaut (59).
Sur fond de gueules, les armoiries de la ville de Valenciennes (59). Sur un chevron d’azur et un croissant d’or, blason de la province de Flandre surmonté de remparts crénelés symbolisant les villes fortifiées. Tenants, deux cygnes au naturel représentant l’origine de la ville. En effet, après avoir sauvé la vie d’un cygne, une princesse fit construire une villa au bord de l’Escaut. Elle l’appela « Val en Cygnes ». Par la suite, les rois mérovingiens qui y firent construire un palais. Peu à peu, « Val en Cygnes » devint Valenciennes. |
|
CRS 15 Béthune (62) |
||
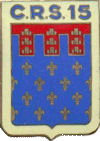 |
La CRS 15 est créée à Lille (59) le 8 janvier 1945, elle séjourne dans le château Filliette à Chocques (62) dans les premiers mois de cette année puis est transférée le 6 octobre 1945 à Béthune (62) dans la cité des cheminots dans les quartiers d’un escadron de la Garde Républicaine Mobile qu’elle occupe encore aujourd’hui. L’insigne représente les armes de l’ancienne province d’Artois. Remerciement à M. Jean-Claude Messéant pour les renseignements complémentaires. |
|
CRS 52 Poitiers (86) puis Sancerre (18) en 1946 |
||
 |
Ancien insigne de la CRS 52 de Sancerre. Taillé dextre : Le blason de la ville de Bourges chef lieu du département du Cher. En 1100, Bourges devint domaine royal. A cette époque, le Berry tirait sa richesse de l’élevage du mouton. C’est pourquoi figure sur l’emblème de la ville les fleurs de lys et trois moutons. Taillé senestre : Le blason de la ville de Sancerre (18) représentant une herse de labour. Sur le beffroi (1510 environ), l’écu figurant au-dessus et à droite de la porte menant de la rue à la salle des échevins, écu martelé sous la Révolution, représente la herse de labour. |
|
CRS 61 Reims (51) puis CRS 33 en 1964 |
||
 |
En chef : Trois lys d’or sur fond d’azur rappellent que Reims (51) est la ville royale des sacres depuis le baptême de Clovis par l’évêque Saint-Rémi en 496.
Tranche : A dextre : d’azur à la bande d’argent côtoyée de deux doubles cotices potencées et contre potencées d’or des comtes de Champagne que commença en 923 la lignée avec Herbert de Vermandois. Les grecques d’or de champagne et la bande d’argent, évoque la province d’origine et le premier nom du “GMR Champagne“. A senestre : la cathédrale de Reims sur fond d’argent retrace le passé historique de la ville et sa vocation touristique. |
|
CRS 62 Troyes (10) puis CRS 35 en 1964 |
||
 |
« D’azur à la bande d’argent côtoyée de deux doubles cotices potencées et contre potencées de treize pièces d’or, au chef cousu d’azur chargé de trois fleurs de lys d’or rangées en fascé »
L’insigne de la CRS représente les armes de la ville de Troyes (10), représentant elles-mêmes celles de Champagne ; les potences (du latin potentia : puissance) des cotices symbolisent les châtellenies relevant des comtes de Champagne. Le chef aux fleurs de lys marque son rattachement à la couronne de France. |
|
CRS 71 Metz (57) puis CRS 30 en 1964 |
||
 |
L’insigne de l’unité représente le « Graoully » supportant le blason de la ville de Metz (57) lui-même surmonté de remparts crénelés rappelant que Metz est une ancienne ville fortifiée. Les couleurs blanches et noires de la ville sont apparues vers la fin du XIVéme siècle et symbolisent la vie et la mort, le bien et le mal. L’origine du « Graoully », monstre à bec de canard qui n’a que deux pattes, remonte au premier siècle et la légende date du moyen-âge. Sa tête fut découverte en 1913 sur les bords de la Seille près de la gare de marchandise. Saint Clément, premier évêque de Metz, montra en les reptiles vivants, l’incarnation de Satan et les affronta dans leur repaire dans l’amphithéâtre romain en ruines rendant l’approche impossible car leur haleine avait empoisonné la contrée. Liant le plus grand de ces serpents en l’entourant de son étole, Saint Clément l’entraîna jusqu’au bord de la Seille et lui ordonna au nom de la Sainte Trinité de passer le fleuve et de disparaître. |
 |
CRS 72 Sarreguemines (57), Thionville (57) en 1957 puis CRS 36 en 1964 |
||
 |
L’unité a été créée en février 1945. Elle stationne à Metz (57) jusqu’au 1er juin et s’installe ensuite à Sarreguemines (57). Le 16 août 1954, un détachement est affecté à Thionville (57) et en février 1957 l’unité est entièrement réunifiée. Tranché d’or : Alérion de gueules (sur le blason de Sarreguemines ce dernier est d’argent) représentant la châtellenie de Lorraine sous une forme plus élégante et plus moderne, ailes éployées, encapuchonnant presque la tête devenue un lys renversé, queue en forme de lys, le bas du corps à trois rangées de plumes dont les deux inférieures en accolade. Tranché de gueules : au lion d’or contourné et couché tenant dans sa patte antérieure gauche un écu d’azur à la croix de lorraine ou croix d’Anjou, emblème des ducs d’Anjou devenus ducs de lorraine. Le lion ainsi présenté représente la souveraineté. |
|
CRS 73 Bergerac (24) en 1952 puis CRS 17 en 1964 |
||
 |
L’implantation de la CRS 73 fût initialement prévue à Vittel (88) à la demande de la municipalité pour faire face à l’affluence touristique. La compagnie devait être casernée dans le bâtiment du « Splendid hôtel », mais celui-ci ne possédant pas de cheminée, l’administration refusa d’y installer la compagnie. Elle fut donc implantée à Bergerac (24) le 13 juin 1952.
Témoignage recueilli auprès de Monsieur Fernand Renard, ancien du GMR “Lorraine” et des CRS 201 et 202. (juin 2008). L’insigne représente la Flamme des CRS terrassant un dragon d’or. La légende rapporte qu’un monstre affreux nommé “La Gratusse” causait d’effroyables ravages dans notre région. Caché dans une caverne, il s’en prenait tout particulièrement aux mariniers de la Dordogne qu’il attirait dans son antre et dévorait. Or, Saint-Front, évêque de Périgueux (24), chassé de cette ville par la persécution qui y sévissait alors, s’était réfugié sur les coteaux qui surplombent la rivière. Comment vint-il à bout de la bête ? En allumant un bûcher et en ordonnant au monstre soumis de s’y entraîner ? En le précipitant dans les flots de la Dordogne ? Plusieurs variantes de la légende subsistent. |
|
CRS 81 Dijon (21) puis CRS 40 en 1964 |
||
 |
L’insigne représente les armoiries de Bourgogne et de Franche-Comté. A dextre : les armes de Bourgogne ; en haut, les armes des ducs de la dynastie des Valois, dont le premier fut en 1363 Philippe le Hardi, duc de Touraine. En bas, les armes de la dynastie des ducs de Bourgogne capétiens fondée en 1032 par Robert Ier le Vieux. A senestre : les armes de Franche-Comté ; le blason porte les armes d’Othon IV, comte palatin de Bourgogne en 1286. |
|
CRS 82 Chalon-sur-Saône (71) puis CRS 43 en 1964 |
||
 |
Créée le 8 décembre 1944, l’unité était implantée au château de la Rochette à Saint-Maurice-des-Champs (71). Le 1er juin 1946 la compagnie prend définitivement ses quartiers à Chalon-sur-Saône (71) à la caserne d’Uxelles.
Au premier plan, sous un ciel d’azur, la tour du doyenné initialement implantée au chevet de la Cathédrale Saint-Vincent, cette tour a connu une “vie” extraordinaire : vendue pierre par pierre à un parisien, elle fut rachetée et remontée en 1927 sur l’île Saint-Laurent. |
|
CRS 83 Auxerre (89), Joigny (89) en 1947 puis CRS 44 en 1964 |
||
 |
Tranché d’azur : les armes du comté de Bourgogne (Franche-Comté) et de la ville d’Auxerre (89) ; ce sont les armes d’Othon IV, comte palatin de Bourgogne en 1286. (Après les ères des invasions la ville fut le siège d’un comté que possédaient les comtes de Nevers, d’où les armes de la ville). Tranché de gueule : Les armes de la ville de Joigny (89) : les remparts rappellent les armes comtales de la dynastie des Noyers (1337-1603). La ville enserrée dans ses murailles rappelle le premier sceau de la cité en 1398. Sur l’ouverture de la porte un maillet le manche en haut. Cet outil fut longtemps utilisé par les vignerons et tonneliers. La tradition veut que les habitants de Joigny (89) aient utilisé leur maillet pour prendre d’assaut le château en 1420. Peut-être qu’ils s’en sont servis aussi pour se défendre au cours des siècles (le maillet était aussi une arme). Le nom de maillotin qu’on donne encore souvent aux habitants de Joigny (89) (le terme “Jovinien” n’apparaît qu’au XIXème siècle) viendrait donc du maillet dont se servaient autrefois les vignerons et tonneliers. |
|
CRS 91 Poitiers (86) puis CRS 18 en 1964 |
||
 |
La CRS 91 est issue du GMR “Poitou” et formée à la libération. L’insigne de la compagnie représente les armes de Poitiers (86). Un lion, rampant de gueules, sur fond d’argent, armé et lampassé d’or, une bordure de sable chargée de neuf besants d’or, celle-ci était chargée de douze monnaies d’or symbolisant les douze échevins. Saint-Louis pris officiellement possession de la ville et la donna en apanage à son frère Alphonse en 1241 qui supprima trois besants pour en laisser neuf, marque du roi Louis IX (Saint Louis). Sur l’insigne de la compagnie les douze besants sont représentés. Le sceau fut orné du chef de France brochant (azur orné de trois fleurs de lys d’or). |
|
CRS 101 Strasbourg (67) puis CRS 37 en 1964 |
||
 |
A dextre : le blason de la ville de Strasbourg A senestre : celui de la Basse-Alsace avec sur le tout la cathédrale Notre-Dame. Avec ses 142 mètres, après avoir été l’édifice le plus haut du monde de 1625 à 1847, elle est actuellement la deuxième plus haute cathédrale de France après celle de Rouen (151 m). Elle est reconnaissable par son unique clocher surmonté d’une flèche. |
  |
CRS 102 Haguenau (67), Le Mans (72) en 1948 puis CRS 10 en 1964 |
||
|
|
Cette unité a été créée officiellement dans le Bas-Rhin au mois de juin 1945. Sa mission principale était alors la surveillance de la frontière franco-allemande.
Au Mans (72), suite à de graves incidents qui se sont produits à l’occasion de manifestations de rues, il est décidé, en mars 1948, du transfert de la compagnie dans cette ville. Description : voir CRS 10 |
|
CRS 103 Mulhouse (68) puis CRS 38 en 1964 |
||
 |
La CRS 103 a pris naissance à Enghien-les-Bains (95). Un an plus tard, l’encadrement de la CRS 103 a été dirigé sur Mulhouse (68). Lors de sa création, cette unité faisait partie du Groupement V de Strasbourg (67) qui réunissait la CRS 101 de Strasbourg (67) et la CRS 102 d’Haguenau (67). Ce groupement a été dissout en 1949, les deux compagnies restantes ont été rattachées au Groupement VI de Metz (57).
Description : voir CRS 38 |
|
CRS 111 Rennes (35) puis CRS 9 en 1964 |
||
 |
Fin mars 1943, le GMR “Bretagne” s’installe à Rennes (35). Après la libération de la ville par les américains le 6 août 1944, il change de nom devenant la Compagnie de Réserve de Bretagne. Une unité fut implantée à Rennes. Le nom de la CRS 111 fut donné, c’est-à-dire la première compagnie de la 11ème région militaire.
Description : voir CRS 9 |
 |
CRS 112 Saint-Brieuc (22) puis CRS 13 en 1964 |
||
 |
L’unité créée le 1er février 1945 à Saint-Laurent-de-la-Mer (22) avec une partie des effectifs du GMR “Bretagne” de Rennes (35), elle s’installa ensuite à Perros-Guirec (22) le 4 juin 1945 et s’implanta définitivement à Saint-Brieuc (22) le 14 juin 1946, résidence actuelle de la CRS 13. L’insigne de l’unité est la représentation des armoiries de la ville de Saint-Brieuc (22) représentant le Griffon, animal fabuleux imaginé au moyen âge est un hybride du lion et de l’aigle, mi-animal terrestre, mi-oiseau. S’agissant d’animaux possédant le symbole de la puissance au plus haut degré, on peut conclure que le griffon, mélange du « Roi des animaux terrestres » et du « Roi des oiseaux » n’est autre que le Roi des animaux fabuleux. |
|
CRS 121 Limoges (87), La Rochelle (17) en 1948 puis CRS 19 en 1964 |
||
 |
L’insigne représente les armoiries de la ville de La Rochelle (17). Le sceau connu est celui dont on trouve l’empreinte suspendue à une charte rochelaise ; sur ce précieux titre, figure consigné le serment de fidélité prêté à Louis VIII après la prise de La Rochelle sur les Anglais en 1224. Sur ce cachet figure un navire, emblème de la ville, voguant à pleines voiles sur une mer agitée et dont l’unique mât est surmonté d’une croix. En 1696, de nouvelles armoiries sont accordées par Louis XIV ; de gueules (pourpres) au vaisseau d’or, habillé d’argent, voguant sur une mer de sinople (mer de couleur verte, bleue sur l’insigne). Au chef d’azur à trois fleurs de lys d’or. |
|
CRS 122 Limoges (87) puis CRS 20 en 1964 |
||
 |
Coupé supérieur le blason de l’ancienne province du Limousin (d’hermine à la bordure de gueules) Coupé inférieur est représenté saint Martial, 1er évêque de Limoges (87), qui implanta le christianisme en Limousin. En 1426, le roi Charles VII, de passage à Limoges, permis de surmonter le buste de Saint Martial d’un bandeau bleu d’azur avec trois fleurs de lys d’or, symbole de la royauté. |
|
CRS 123 Périgueux (24) puis CRS 22 en 1964 |
||
 |
L’insigne de la CRS 22 est en relation avec la vie du Maréchal Bugeaud de la Piconnerie, duc d’Isly, qui a été député de la Dordogne en 1831. Sa devise : « Ense et Aratro », a été reprise et figure sur le fanion de l’unité autour de l’insigne.
– Les étoiles dorées sur fond de gueule représentent les étoiles du général qu’il avait pendant la conquête de l’Algérie. « Par l’épée et par la charrue » sont les symboles matériels de sa devise car il a organisé sa conquête en créant des routes et des villages et en transformant ses soldats en ouvriers et en colons. |
|
CRS 131 Clermont-Ferrand (63) puis CRS 48 en 1964 |
||
 |
Issue des effectifs du GMR “Auvergne”, la CRS 131 ne reprend pas l’insigne du GMR dont elle est originaire mais celui représentant Vercingétorix du GMR “Gergovie” implanté avant 1944 à Montluçon (03).
Est représenté sur cet insigne, la statue de Vercingétorix, surmonté d’un casque gaulois d’or, se retournant pour un appel aux armes, l’épée tendue vers l’avant et foulant sous les sabots de son cheval un soldat romain terrassé. Cette statue, sculptée par Bartholdi, est installée face au Puy-de-Dôme place de Jaude à Clermont-Ferrand (63). Elle porte l’inscription : j’ai pris les armes pour la liberté de tous. |
|
CRS 132 Riom (63), Saint-Etienne en 1948,
|
||
 |
Créée en août 1945 à Chatelguyon (63), la CRS 132 est transférée à Riom (63) en avril 1947. En avril 1948, elle est rattachée au groupement de Lyon (69) et désignée pour remplacer à Saint-Etienne (42) les CRS 145 et 146 dissoutes. Elle s’installe définitivement à La Talaudière (42) en juin 1963.
|
|
CRS 133 Montluçon (03) puis dissoute en 1964 |
||
 |
Sur le tranché senestre, le château de Montluçon (03) qui fut édifié sur une hauteur dominant la vallée du Cher, d’où le blason. Dans la devise de la ville, la montagne lumineuse (mons lucens), c’est à dire le soleil, est une interprétation de Mons Lucii, la colline de Lucius, général romain qui commandait la légion romaine à Neriomagus, aujourd’hui Néris-les-Bains (03).
Sur le tranché dextre, l’ancienne province du Bourbonnais est celui du département de l’Allier. Il est aux armes de la troisième maison de Bourbon. |
|
CRS 134 Grenoble (38), Roanne (42) en 1951 puis CRS 34 en 1964 |
||
 |
Écu écartelé représentant :
– Sept fleurs de lys d’or sur fond azur : province du lyonnais rattachée au royaume de France. |
|
| CRS 141 Albigny-sur-Saône (69), Lyon (69) en 1949 puis CRS 45 en 1964 | ||
 |
Créée en le 15 janvier 1945 à Albigny-sur-Saône (69), l’unité est transférée au fort Montluc à Lyon (69) le 1er septembre 1949. Elle s’implante définitivement à Chassieu (69) en février 1982.
Les armes de la ville de Lyon (69) surmontées d’un heaume de chevalier. |
|
CRS 142 Sainte-Foy-lès-Lyon (69) puis CRS 46 en 1964 |
||
 |
Créée le 1er aout 1945 à Sainte-Foy-Lès-Lyon (69), la CRS 142 accueille dans ses rangs l’année suivante de nombreux éléments issus de la CRS 143 dissoute.
Ecu écartelé représentant : Ces quatre villes représentent les provinces du Lyonnais, du Beaujolais, du Forez et du Jarez qui formaient l’ancien département du Rhône et Loire. |
|
CRS 147 Grenoble (38) puis CRS 47 en 1964 |
||
 |
Créée au château Chapuis à Moirans (38), la CRS 147 s’installe en février 1947 à la caserne Dode à Grenoble (38) jusqu’au 19 novembre 1984.
L’insigne de la CRS 147 représente un chamois sur fond de montagnes très proches de la ville qui faisait dire à Stendhal « Au bout de chaque rue, une montagne ». Grenoble est située entre les massifs du Vercors (au Sud-ouest), de la Chartreuse (au Nord) et la chaîne de Belledonne (à l’Est). Elle est approximativement au centre de la partie française des Alpes et est à ce titre souvent considérée comme la « capitale des Alpes ». |
 |
CRS 148 Valence (26) dissoute en 1946 et remplace la CRS 174 Marseille (13) |
||
 |
Ecu de base : en chef, la devise « Je maintiendrai » Sur le tout, écu représentant la croix de gueules du Valentinois, écartelé comme suit : – Fond de gueules – – Le dauphin, emblème de l’ancienne province du Dauphiné et du département de la Drôme. – Le blason de Valence (26) ; la tour et la croix rappellent la souveraineté de l’évêque, seigneur de la ville qui s’instituait en 1110 comte de Valence.Sur cet écu, au centre, une médaille représentant la flamme des CRS avec l’inscription ” Rhône-Alpes CRS 148 “ |
|
CRS 149 Donzère (26) (crée en 1952),
|
||
 |
– Canton dextre : le blason de la ville de Montélimar (26). Etant qualifiée de “bonne ville” en 1164, le seigneur Giraud-Adhémar obtint de l’empereur Frédéric une bulle qui lui assurait la possession indépendante.
– Canton senestre : Le dauphin, emblème de l’ancienne province du Dauphiné et du département de la Drôme (26). – Coupé inférieur : Le barrage de Donzère-Mondragon mis en service en 1952. Il est le plus productif sur le Rhône et comprend le plus long canal de dérivation et la plus haute écluse du Rhône. |
|
CRS 156 Avignon (84) (Le Pontet) dissoute en 1948 |
||
 |
L’insigne de la CRS 156 reprends le profil de Marianne coiffée d’un bonnet phrygien rouge agrémenté d’une cocarde. Autour de la Flamme des CRS la devise “Vaincre et vivre” du colonel Fabien. Sur le tout, en pointe : Le blason d’Avignon. (avec ses trois clefs, l’une symbole de la seigneurie autonome qu’elle fut avant d’être acquise en 1348 par le pape Clément VI, d’où les deux autres clefs, symbole du pouvoir pontifical). La loi du 27 décembre 1947 prononça la dissolution de tout le groupement n°6 de Marseille (13), c’est à dire les compagnies 151, 152, 153 de Marseille, 154 Aix-en-Provence, 155 Ollioules, 156 Avignon, et 157, 158 Nice ainsi que les trois compagnies du département de la Loire, la 144 de Roanne et les 145 et 146 de Saint-Etienne. |
|
CRS 161 Montpellier (34) puis CRS 56 en 1964 |
||
 |
L’insigne de la compagnie représente le Languedoc et la ville de Montpellier (34). Les couleurs de l’écu sont de gueule (couleur de l’emblème du Languedoc) et d’azur (couleur de fond des armoiries de la ville). Dans le taillé dextre la croix de Toulouse ou croix de Languedoc. Dans le taillé azur est représenté le château d’eau dominant la promenade du Pêyrou. Il reçoit les eaux de la source Saint-Clément et alimente les nombreuses fontaines de la ville et c’est autour de cette colline que Montpellier (34) s’est édifiée au fil des ans. Enfin dans la pointe, quelques vagues rappellent que le département de l’Hérault a une large ouverture sur la mer. |
|
CRS 162 Uzès (30) dissoute en 1964 |
||
 |
A son rapatriement d’Algérie, en 1961, la CRS 199 de Sétif est stationnée en Avignon et en 1964, la 162 d’Uzès (30) et la 199 sont dissoute pour constituer la CRS 60 à partir de ces deux unités le 1er janvier 1964.
L’insigne de la compagnie représente le Château Ducal appelé le “Duché”. Il est par son architecture un résumé de l’histoire de France. Le Moyen-âge, la Renaissance, le Siècle des Lumières et les Temps Modernes s’y retrouvent. Cette composition architecturale offre malgré cela une belle harmonie au regard. |
|
CRS 163 Carcassonne (11) puis CRS 57 en 1963 |
||
 |
Le 1er juillet 1945, la CRS 163 prend possession du casernement au lieu dit Bouttes-Gach, route de Toulouse mais en 1976 un violant incendie ravage les bâtiments et l’année suivante la compagnie s’installe définitivement dans ses locaux actuels. Les 2 premiers chiffres (16) ont pour origine la 16ème région militaire de Montpellier (34) qui coiffait 4 compagnies : la 161 Montpellier (34), la 162 Uzès (30), la 163 Carcassonne (11) et la 164 Perpignan (66). L’écusson s’inspire des armes de Carcassonne (11). Ce blason représente un écu à fond d’azur, semé de fleurs de lys d’or, au centre, la porte Narbonnaise stylisée, au cœur de la porte, un blason à fond de gueule sur lequel figure l’agneau Pascal, symboles du retour de la ville à la foi catholique et de sa soumission au roi. Les trois couleurs sont celles du drapeau français, le motif central de la porte Narbonnaise se voyant rajouter le donjon du château central, l’agneau Pascal ne convenant pas à la vocation républicaine et laïque laissera place à une croix cléchée dite croix de Toulouse plus connue sous le nom de croix Occitane. Les fleurs de lys seront stylisées et resteront au nombre de trois sur le bandeau azur. Leur nombre réduit peut faire croire que le ralliement de Carcassonne (11) au Roi de France est postérieur au XIVème siècle. Ce choix délibéré, que pardonneront les puristes, n’est dicté que par un souci esthétique et n’enlève en rien l’attachement sentimental que les habitants portent à leur cité et à son histoire. |
|
CRS 164 Perpignan (66) puis CRS 58 en 1964 |
||
 |
Au fond de l’insigne, le drapeau catalan couvrant le massif des Pyrénées Orientales (le Canigou) rappelant qu’intervient, que depuis 1957, une section de secours en montagne. Au premier plan est représenté, au bord de la mer Méditerranée, le château du Castillet. Ce haut château fort de brique était, à l’origine de sa construction au XIVème siècle, la porte principale de la ville. Elle protégeait à la fois contre l’envahisseur, mais aussi contre les débordements d’une cité souvent frondeuse. Transformé en prison aux XVIIIème et XVIIIème siècles, il abrite désormais la Casa Pairal (maison des ancêtres), musée d’Arts et Traditions populaires catalanes. |
|
CRS 165 Marseille (13) puis CRS 53 en 1964 |
||
 |
Les trois premières CRS Marseillaises ont été créer le 8 janvier 1945 il s’agissait des CRS 151, 152 et 153. Elles faisait partie du Groupement de Marseille (13) qui fut dissout disciplinairement par la loi du 27 décembre 1947 entraînant avec lui les CRS 154 Aix-en-Provence, 155 Toulon (83), 156 Avignon (84) et 157, 158 Nice (06).
Description : voir CRS 53 |
|
CRS 166 Marseille (13) puis CRS 54 en 1964 |
||
 |
Tiercé central : Sur une île de l’archipel du Frioul, le château d’If, ancienne forteresse construite sous François Ier en 1524, il devient prison d’état au XVIIème siècle. Le roman d’Alexandre Dumas, “le comte de Monte-Cristo” l’a rendu célèbre. Tiercé dextre : Un vaisseau figurant la puissance maritime de Marseille. Tiercé senestre : les armes de Provence. En 1481 le roi Louis XI réalisa l’union définitive de la Provence à la couronne. Ce blason est une simplification des armes que portait Charles d’Anjou. Le gousset renversé symbolise le delta du Rhône. En pointe : le blason de la ville de Marseille. |
 |
CRS 171 Toulouse (31) puis CRS 26 en 1964 |
||
 |
De gueule et or sont les deux couleurs de la croix de Toulouse (31), du Languedoc.
La croix de Toulouse rappelle l’origine territoriale de la CRS 26. Habituellement, elle est représentée d’or sur champ de gueules. |
|
CRS 172 Toulouse (31) remplace la CRS 152 de Marseille (13) en 1948,
|
||
 |
Taillé dextre : sur fond d’azur, la mer, le soleil et une mouette, représentant la région Méditerranéenne. Taillé senestre : fond de gueule et bandes verticales or représentent les couleurs de la Provence, en incrustation l’écusson de la ville de Marseille : la croix est le symbole choisi par les Marseillais au XIIème siècle pour inspirer confiance aux croisés pour les attirer vers le port. |
|
CRS 173 Montauban (82) puis CRS 28 en 1964 |
||
 |
Le 1er février 1945 création de la CRS 173 qui est logée dans le cantonnement de la CRS 171 de Toulouse (31). Le 4 mars de la même année elle s’installe définitivement à Montauban (82).
« Lion d’argent armé et lampassé, la queue fourchue bondissant sur fond de gueules entrecroisées d’azur » Le saule représenté sur le canton dextre de la pointe représente un saule qui représente étymologiquement MONTAUBAN de deux façons : |
|
CRS 174 Albi (81) dissoute en 1948
|
||
 |
La CRS 174 d’Albi (81) à été dissoute en 1948 et remplacée par les effectifs de la CRS 148 de Valence (26) et déplacée à Marseille (13) puis dissoute en 1964.
Sous le soleil rayonnant de la côte d’azur, voguant sur les ondes, un paquebot invitant à une croisière sur la méditerranée, le blason d’or au quatre pals de gueules du Roussillon, le blason de gueule à la croix cléchée du Languedoc et la blason d’argent à la croix d’azur de la ville de Marseille (13). |
|
CRS 175 Lannemezan (65) puis CRS 29 en 1964 |
||
 |
Créée en février 1945 à Toulouse (31), la CRS 175 devait être implantée initialement à Montauban (82). Le 1er mars 1945, elle s’installe à Auch (32) jusqu’en avril 1946, où elle est transférée définitivement à Lannemezan (65).
Sur fond azur avec un isard de pourpre posé sur une montagne argent. |
|
| CRS 176 Toulouse (31) puis CRS 27 en 1964 | ||
 |
L’unité est crée le 16 avril 1951 avec les anciens de la CRS 172 de Toulouse (31) majoritairement originaires de la région.
Taillé dextre : Le donjon du Capitole, cette ancienne tour des archives abritait les documents précieux et les archives de la ville. Au début du XIXème siècle, il fut restauré par Viollet-le-Duc qui lui restitua ses tourelles et lui donna son apparence de beffroi. Depuis 1946, l’office du tourisme est installé dans le Donjon. |
|
CRS 181 Bordeaux (33) puis CRS 14 en 1964 |
||
 |
Les fleurs de lys d’or sur fond d’azur représentent la monarchie Royale. Le léopard d’or, sur fond de gueules, rappelle que Bordeaux (33) était la capitale de la province de Guyenne. Le château reproduit les tours de l’ancien hôtel de ville dont il reste aujourd’hui la Grosse cloche de la ville de Bordeaux (33). Les eaux de la Garonne baignent ces tours et le croissant symbolise la courbe décrite par le fleuve devant la ville et le port de la Lune. |
|
CRS 182 Agen (47) puis CRS 24 en 1964 |
||
 |
A sa création en avril 1945, l’unité s’est implantée, par réquisition, au château de la Couronne à Boé (47).
Les armoiries de l’insigne de compagnie sont celles de la ville d’Agen (47). De gueules, à un aigle volant de profil, d’argent, tenant de ses pattes une liste du même, sur laquelle est écrit « AGEN » en lettres capitales, de sable, posées à dextre, et une tour d’or, couverte en pavillon de trois pièces, girouetté du même et posée à senestre : desquelles armoiries avaient été accordées à la dite ville par les Rois. |
|
CRS 183 Pau (64), Ollioules (83) en 1948 puis CRS 59 en 1964 |
||
 |
Le 1er février 1945, le GMR “Estérel” fait place à la CRS 155 (5ème compagnie de la 15ème région militaire). La compagnie est dissoute en décembre 1947 et tout le personnel est licencié à compter du 1er février 1948. Une partie a été réintégrée individuellement entre le 1er janvier et le 1er avril 1948, date du changement de résidence de la CRS 183 de Pau (64) à Ollioules (83). Sur fond d’azur, un rameau d’olivier et un ombre-chevalier transpercé d’un épée se rapportant au domaine de Castel’ Ombre où est toujours implantée la compagnie. |
|
CRS 184 Pau (64) en 1962 puis CRS 25 en 1964 |
||
 |
Coupé supérieur : Sur fond azur, le casque et le panache blanc du roi Henri IV, (il né à Pau en 1553 et fut assassiné par Ravaillac en 1610 à Paris).
Franc quartier inférieur dextre : blason de la Basse-Navarre. De gueules aux chaînes d’or posées en orle, en croix et en sautoir, chargées en cœur d’une émeraude au naturel. |
|
CRS 201 Nancy (Jarville-la-Malgrange) (54) puis CRS 39 en 1964 |
||
 |
Écusson d’or se décomposant ainsi : – Bande de gueules à trois alérions d’argent. – Chardon sur tranché du canton du chef sénestre. – Croix de lorraine sur canton de la pointe dextre. La légende dit que, au siège de Jérusalem, Godefroi de Bouillon, Duc de Basse Lorraine, remarque trois alérions identiques s’élevant dans les airs d’un même mouvement. Se saisissant de son arc, il tira une seule et même flèche qui transperce et unit les trois alérions, réalisant ainsi le présage attendu pour désigner le roi de Jérusalem. En héraldique, les alérions sont en fait de tous petits aigles dépourvus de bec et de serres, c’est-à-dire pacifiques. Ils symbolisent ici Dieu, qui est Un et Trois à la fois. Il plaça ces trois alérions dans ses armes en souvenir de cet exploit. Alérion est l’anagramme du mot lorrain “LOREINA” Le chardon de Nancy (54) fut l’emblème du Duc René II. Après 1477, les Lorrains s’approprièrent l’emblème de leur souverain et devint le symbole de l’énergique résistance de la ville à Charles le Téméraire. Celui-ci est considéré comme une allusion à la résistance nationale contre l’ennemi Bourguignon : « Non Inultus Premor » (qui s’y frotte s’y pique). La croix de Lorraine, transmise par les Ducs d’Anjou, devenus Ducs de Lorraine en 1473, représente un reliquaire avec un double croisillon. Elle devint l’emblème de la France Libre lorsque le capitaine de corvette Thierry d’Argenlieu écrivit en 1940 à De Gaule qu’il fallait aux Français libres une croix pour lutter contre la croix gammée. |
|
CRS 202 Villers-lès-Nancy (54) dissoute en 1947 |
||
| Pas image, l’insigne n’a jamais été créé. |
La CRS 202 à été créée en 1945 et implantée au château Saint-Fiacre à Villers-Lès-Nancy (54). L’administration décida de déplacer la compagnie à Briey (54), caserne Igert, occupée avant la guerre par des Gardes Mobiles, mais devant le refus du personnel de subir ce déplacement, elle dissout la CRS 202 le 1er février 1947. Les effectifs mariés avec enfants furent affectés en surnombre à la CRS 201 de Nancy (54), les célibataires et mariés sans enfant furent mutés et répartis entre les CRS 71 de Metz (57), 72 de Sarreguemines (57), 103 de Mulhouse (68) et 101 de Strasbourg (67).
Témoignage recueilli auprès de Monsieur Fernand Renard, ancien du GMR “Lorraine” et des CRS 201 et 202. (juin 2008) |
|

